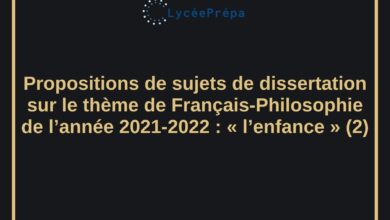Commentaire du troisième paragraphe de la préface à la seconde édition du Gai savoir de Friedrich NIETZSCHE

Le troisième, et avant dernier, paragraphe de la préface à la seconde édition du Gai savoir de NIETZSCHE s’ouvre sur l’expression de reconnaissance de NIETZSCHE envers toutes les cibles de sa critique à savoir ces versions de philosophie, de morale, de religion, de science qui nient la vie du corps et cherchent, moyennant le seul esprit, coûte que coûte à fonder des vérités immuables. Lesquelles constituent, pour le philosophe, des formes de nihilisme. Fidèle à son attitude à l’égard des auteurs (auteur est à comprendre ici dans le sens de « qui est à l’origine de ») de la décadence de la culture européenne, NIETZSCHE construit une philosophie de l’affirmation, il l’érige sans pour autant s’opposer aux autres philosophies. Sa démarche consiste, disons-nous, à proposer une pensée en parallèle avec celle existant déjà.
Il exprime ladite reconnaissance de manière à impliquer le lecteur qui devrait ainsi la lire entre les lignes puisqu’il s’agit de la « deviner » comme le traduit le propos nietzschéen suivant :
« On devine que je ne voudrais pas me montrer ingrat au moment de prendre congé de cette époque de grave consomption dont je n’ai pas encore épuisé le bénéfice aujourd’hui. » (P. 29)
Ainsi, ne pas être « ingrat » c’est plutôt être reconnaissant. Mais, quel est l’objet de cette reconnaissance ? Il s’agit, semble-t-il, de reconnaitre aux autres philosophes de permettre à l’auteur du Gai savoir de créer une pensée sur les ruines de leurs philosophies qui valorisent l’esprit comme lieu de toute réflexion au détriment du corps.
À la différence de ces philosophes de système, ces penseurs assujettissant la philosophie à un cadre, à un système en cherchant par là même à configurer la pensée dans un tout homogène et rigide, un bloc dont les éléments sont solidaires comme le trahit l’expression « monolithique[1] de l’esprit », NIETZSCHE produit une philosophie bigarrée[2] qui se veut la traduction des changements des états de son corps comme le laisse entendre le propos suivant : « je sais assez l’avantage que me procure ma santé au variations nombreuses sur tous les monolithiques de l’esprit. » (P. 29) Disons, en d’autres termes, que la pensée de NIETZSCHE trouve son origine et sa cause première dans ses multiples états de santé comme ledit le groupe nominale « ma santé aux variations nombreuses » et le confirme l’affirmation suivante : « un philosophe qui a cheminé et continue toujours de cheminer à travers beaucoup de santés a aussi un nombre égal de philosophies. » C’est dire qu’il y a autant de philosophies que d’états de santé, que la pluralité des philosophies est, en un mot comme en cent, proportionnelle à celle des états du corps.
Cela étant établi, NIETZSCHE revient encore une fois sur l’objet de toute philosophie, le travail du philosophe, ce qu’est la philosophie tout simplement. Chose qu’il définit comme suit :
« il (le philosophe) ne peut absolument pas faire autre chose que transposer à chaque fois son état dans la forme et la perspective les plus spirituelles, – cet art de la transfiguration, c’est justement cela, la philosophie. » (P. 29)
La mission qui incombe au philosophe consiste donc, d’après NIETZSCHE, à cohérer le travail souterrain qui se fait à l’intérieur du corps (voir le début du commentaire du deuxième paragraphe de cette préface) et dont les agents sont les instincts, les pulsions, les affects… et le travail de l’esprit. Autrement dit, le philosophe est un adaptateur qui rend ledit travail du corps compatible avec les exigences de l’esprit en ce sens qu’il « transpose, procède à la transfiguration » c’est-à-dire qu’il change (comme le souligne le préfixe « trans-» qui renvoie à l’idée de changement) d’une part la position, le lieu et de l’autre la forme de la pensée en la faisant passer d’un premier état, pensée dont l’origine est le corps à un état final, celui d’une pensée prenant une forme spirituelle. Si la pensée part du corps et finit par épouser la forme spirituelle, il est, en conséquence, inconcevable de dissocier corps et esprit sous prétexte d’élaborer une pensée objective car, tout simplement, une telle pensée ne saurait exister. La pensée est plutôt fruit de l’expérience subjective de tout un chacun comme nous le lisons sous la plume de NIETZSCHE dans ces termes : « nous devons constamment enfanter nos pensées à partir de notre douleur et leur transmettre maternellement tout ce qu’il y a en nous de sang, de cœur, de feu, de plaisir, de passion, de torture, de conscience, de destin, de fatalité. (P. 30) NIETZSCHE recourt à la métaphore de l’accouchement pour insister, paraît-il, sur ce rapport combien étroit de la pensée au corps : la pensée naît du corps et se nourrit du même corps, de ce que ressent ledit corps comme « plaisir, passion, torture… » C’est dire encore une fois que la réflexion épouse l’état du corps et partant qu’elle ne pourrait être que subjective.
Nous assistons également, dans ce troisième paragraphe de ladite préface, à la conception de NIETZSCHE de la vie, de ce qu’est « vivre » à travers le propos suivant : « Vivre cela veut dire pour nous métamorphoser constamment tout ce que nous sommes en lumière et en flamme. » (P. 30) Ainsi NIETZSCHE définit-il, par ricochet[3], le fait de « vivre » comme étant un changement permanent, une conversion de ce qui fait l’homme en lumière et en feu. Dit autrement, vivre consiste à lutter contre tout ce qui, en nous, est source d’ombre et de ténèbres, à mener une guerre sans merci contre ce qui, en nous, favorise l’extinction du moi, et en dernière analyse, vivre serait affronter bravement tout ce qui, en l’homme, l’accule à l’effacement, tout ce qui l’affaiblit, tout ce qui se meurt[4] en lui ou du moins appelle à la mort, l’ambition d’objectivité y comprise.
NIETZSCHE revient par la suite sur l’importance de la maladie et se demande s’il est possible de s’en passer dans l’interrogation suivante : « ne serions-nous pas presque tentés de demander s’il nous est seulement possible de nous en dispenser ? » C’est dire qu’il est quasi impossible de vivre sans douleur, sans expérience corporelle éprouvante. Cette nécessité de la douleur apparaît plus clairement dans le propos nietzschéen suivant : « Seule la grande douleur est l’ultime libératrice de l’esprit, en ce qu’elle est le professeur du grand soupçon. » Lequel propos met en lumière l’intérêt que revêt la souffrance et qui n’est autre que d’apprendre à l’homme à douter et partant lui permettre de s’affranchir du carcan de la certitude. Dit autrement, c’est grâce à la douleur que l’homme remet en question les vérités qui figent la vie, et cherchent à tout prix à ordonnancer un univers essentiellement chaotique et ce pour être dans le repos et le confort. Il s’agit, en un mot, de quitter la certitude afin de quêter l’incertitude.
Aussi ladite douleur est-elle avantageuse à l’homme en ce sens qu’elle l’aide à voir clair en lui-même, à porter un regard lucide sur sa propre personne, sa propre vie et ce loin de tout conformisme et de toute illusion comme le trahit l’extrait suivant :
« Seule la grande douleur, cette longue, lente douleur qui prend son temps, dans laquelle nous brûlons comme sur du bois vert, nous oblige, nous philosophes, à descendre dans notre ultime profondeur et à nous défaire de toute confiance, de toute bonté d’âme, de tout camouflage, de toute douceur, de tout juste milieu, en quoi nous avons peut-être autrefois placé notre humanité. »
Dit autrement, la grande souffrance contraint l’homme, le philosophe en particulier, à faire face à lui-même, à se regarder en face, à découvrir le leurre identitaire dont il est, jadis, l’otage : l’illusion de confiance en soi, de bonté, bref, tout ce qui n’est que superficiel et factice. Ainsi et grâce à la douleur, l’homme se rendra compte de cette part cachée de sa personne et qui est faite de soupçon, de méchanceté… Et c’est justement là où réside l’importance de ladite douleur comme le conforte le propos nietzschéen suivant : « Je doute qu’une telle douleur « améliore » – ; mais je sais qu’elle nous approfondit. » La souffrance si elle ne rend pas meilleur, elle demeure une occasion de se connaître, elle est critère de connaissance de soi loin de tout déguisement des moments de confort.
D’après NIETZSCHE, il existe deux façons de réagir à la douleur :
« Soit que nous apprenions à lui opposer notre fierté, notre ironie, notre force de volonté […] soit que, face à la douleur nous nous retirions dans ce néant oriental – on l’appelle nirvana-, dans cet abandon de soi, cet oubli de soi, cette extinction de soi.»
Il est donc deux attitudes à adopter face à la douleur : la première est de s’en moquer, de la narguer, de la mépriser, de la confronter pour accroître et augmenter notre force de vivre car elle (la douleur) est une résistance à l’accès au bonheur et toute résistance est à vaincre, à surmonter afin de cheminer vers « un bonheur nouveau », la seconde réaction est inspirée du bouddhisme et surtout du principe de nirvana[5] elle consiste à être imperméable à ladite douleur, à en devenir insensible et ce moyennant la maîtrise du corps (lieu où se ressent, se manifeste cette douleur), par le contrôle de cette matière (le corps) : l’esprit domine la matière. NIETZSCHE s’inscrit, évidemment, en faux contre la deuxième attitude qui se veut une forme de nihilisme du moment qu’elle étouffe la vie du corps.
[1] Dont les éléments forment un bloc.
[2] Formée d’éléments divers.
[3] Indirectement.
[4] Être sur le point de mourir.
5 Extinction du désir humain donnant lieu à un état de sérénité et de béatitude.
Commentaire réalisé par Radouane ELAMRAOUI