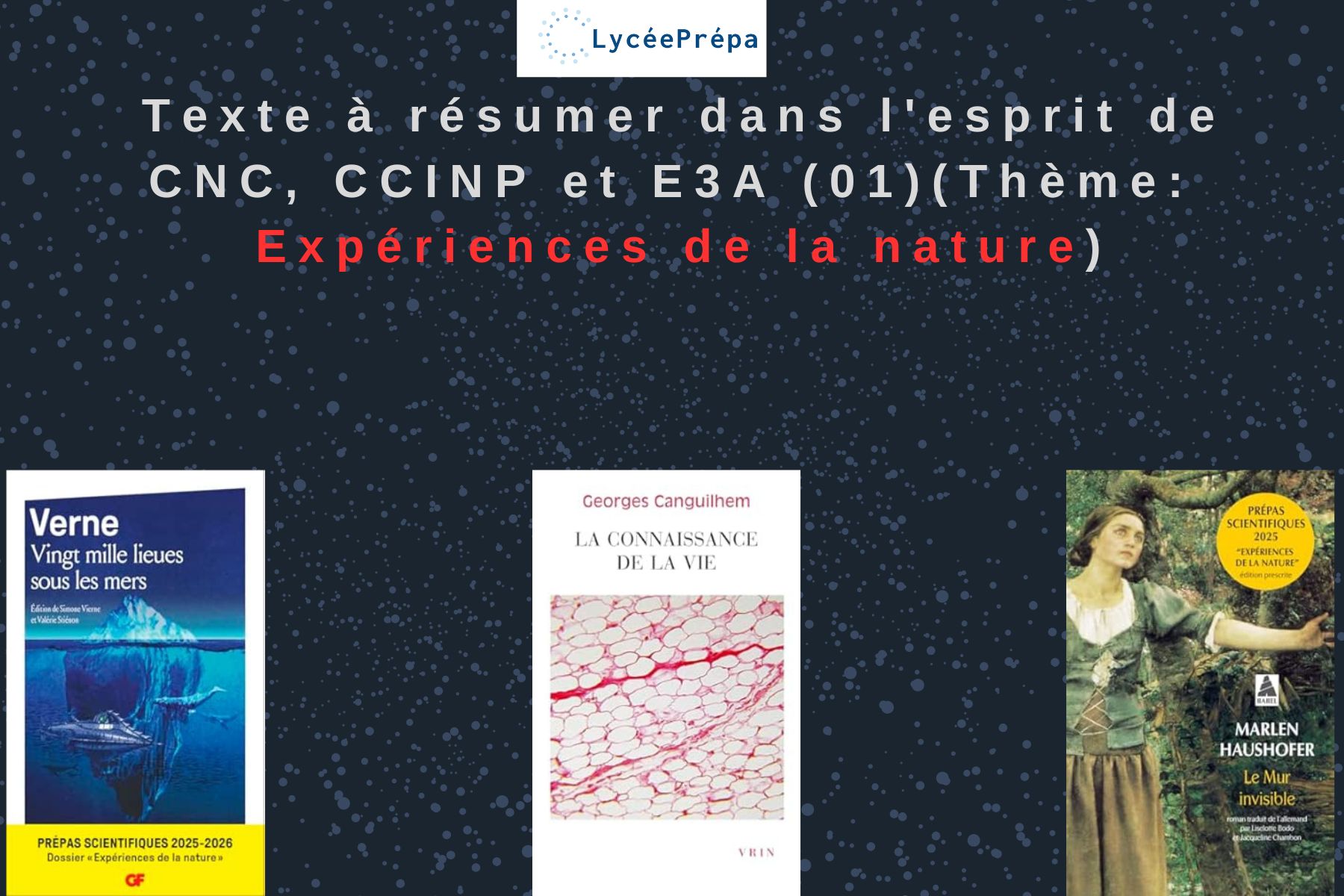
Vous résumerez le texte ci-dessous en 100 mots avec une marge de 10% en plus ou en moins.
« Pas pour se retirer du monde, s’enclore, s’écarter, tourner le dos aux conditions et aux objets du monde présent. Pas pour se faire une petite tanière dans des lieux supposés préservés et des temps d’un autre temps, en croyant renouer avec une innocence, une modestie, une architecture première, des fables d’enfance, des matériaux naïfs, l’ancienneté et la tendresse d’un geste qui n’inquiéterait pas l’ordre social… Mais pour leur faire face autrement, à ce monde-ci et à ce présent-là, avec leurs saccages, leurs rebuts, mais aussi leurs possibilités d’échappées. Loin du cabanon solitaire de Thoreau (qui élaborait près du lac de Walden une réflexion sur les vertus d’une vie à l’écart, même si la solitude d’une aventure rendue à la nature s’y concevait comme une révolte). Faire des cabanes aux bords des villes, dans les campements, et au cœur des villes, sur les places, dans les joies et les peurs. Sans ignorer que c’est avec le pire du monde actuel (de ses refus de séjours, de ses expulsions, de ses débris) que les cabanes souvent se font, et qu’elles sont simultanément construites par ce pire et par les gestes qui lui sont opposés.
Surtout pas pour prendre place, se faire une petite place là où ça ne gênerait pas trop, mais pour accuser ce monde de places – de places faites, de places refusées, de places prises ou à prendre.
Faire des cabanes sans pour autant se contenter de peu, s’accommoder de précarités de tous ordres, et encore moins les enchanter – sans jouer aux nomades ou aux démunis quand justement on ne l’est pas. Mais pour braver ces précarités, leur opposer des conduites et des convictions. Des cabanes qui ne sauraient soigner ou réparer la violence faite aux vies, mais qui la signalent, l’accusent et y répliquent en réclamant très matériellement un autre monde, qu’elles appellent à elles et que déjà elles prouvent.
Faire des cabanes sans forcément tenir à sa cabane – tenir à sa fragilité ou la rêver en dur, installée, éternisable –, mais pour élargir les formes de vie à considérer, retenter avec elles des liens, des côtoiements, des médiations, des nouages. Faire des cabanes pour relancer l’imagination, élargir la zone à défendre, car « de la ZAD », c’est-à-dire de la vie à tenir en vie, il y en a un peu partout sur notre territoire. Faire des cabanes, donc, pour habiter cet élargissement même.
Faire des cabanes alors : jardiner des possibles. Prendre soin de ce qui se murmure, de ce qui se tente, de ce qui pourrait venir et qui vient déjà : l’écouter venir, le laisser pousser, le soutenir. Imaginer ce qui est, imaginer à même ce qui est. Partir de ce qui est là, en faire cas, l’élargir et le laisser rêver. Cela se passe à même l’existant, c’est-à-dire dès à présent dans la perception, l’attention et la considération : une certaine façon de guetter ce qui veut apparaître, là où des vies et des formes de vie s’essaient, tentent des sorties hors de la situation qui leur est faite ; et une certaine façon d’augmenter ces poussées, de soutenir les liens en voie de constitution, de prendre soin des idées de vie qui se phrasent, parfois de façon très ténue, comme autant de petites utopies quotidiennes : oui, on pourrait vivre aussi comme ça.
Jardiner : il ne s’agit pourtant pas de réserver l’espérance politique à des lisières et des gestes de peu, et d’encourager une frugalité en toutes choses. « Jardiner » revient comme un mot lesté d’une nouvelle audace, et le « jardin » excède ici tout pré carré. C’est une pratique plus vaste, un grand appel d’air, une réoccupation de l’avenir, un éperon, une chance de se rapporter d’une nouvelle manière à l’existant, dans cette situation très mêlée, indémêlable. Gilles Clément nous a réappris ce que c’est que jardiner : c’est privilégier en tout le vivant, « faire » certes, mais faire moins (ou plutôt : faire le moins possible contre et le plus possible avec), diminuer les actions et pourtant accroître la connaissance, refaire connaissance (avec le sol, avec ses peuples), faire place à la vie qui s’invente partout, jusque dans les délaissés… On peut agir comme on jardine : ça veut dire favoriser en tout la vie, parier sur ses inventions, croire aux métamorphoses, prendre soin du jardin planétaire ; on peut penser comme on jardine ; on peut bâtir comme on jardine (cela demande de mêler architecture pérenne et architecture provisoire, de ne pas tout vouloir « installer », de prendre des décisions collectives sur ce que l’on gardera, et ce dont au contraire on accepte la disparition). Il ne s’agit pas de désirer peu, de se contenter de peu, mais au contraire d’imaginer davantage, de connaître davantage, de changer de registre d’abondances et d’élévations.
Jardiner les possibles ce n’est décidément ni sauver ni restaurer, ni remettre en état, ni revenir ; mais repartir, inventer, élargir, relancer l’imagination, déclore, sauter du manège, préférer la vie.
Cela se fait parfois doucement et à bas bruit ; comme dans ce projet de « renaturation » d’une rivière genevoise, l’Aire, réalisé par Georges Descombes, qui justement ne tentait pas de refaire la nature, d’y retourner, de reconduire le cours d’eau à son ancien lit afin de maternellement l’y border ; mais créait à l’intention de cette eau trop longtemps canalisée un nouveau terrain de jeu, une sorte de damier pas du tout naturant, du béton quadrillé gardant justement le souvenir de sa canalisation, mais pour que désormais l’eau s’y ébatte, y refasse ses lignes et ses débordements.
Nos cabanes ne seront pas nécessairement plaisantes, légères. Elles diront aussi bien ce qui se tente que ce qui se malmène, ce qui s’essaie que ce qui se voit rabattu, maltraité. Elles diront quelque chose de ce monde de violences en tous genres, de vulnérabilités, de confiscations, de destruction des sols, et pourtant aussi d’espérances, de bravades et d’imaginations pratiques. »
Marielle Macé, Nos cabanes